 |
Autoportrait
1928
Graphite
20 x 16 cm |
|
 |
Violon
1940
Huile sur panneau
Oil on panel
102 x 51 cm |
|
 |
Port de Montréal
1963
Huile sur panneau
Oil on panel
122 x 155 cm |
|
 |
Intérieur
studio Giunta
1979
Huile sur panneau
Oil on panel
91,5 x 81 cm |
|
|
Né le 2
octobre 1911 à Montréal, Joseph Giunta est le fils
d’une famille d’immigrants italiens originaires de Sicile.
Rien, dans le contexte familial, ne le prédispose à une
carrière artistique, même si sa mère a comme loisir
la peinture sur chevalet. Son père est barbier et entrevoit pour
son fils un avenir confortable dont rêvent tous les immigrants
débarqués en terre d’Amérique après
avoir abandonné leur pays natal; Giunta, à l’instar
de Matisse, est destiné à faire des études de
médecine ou de droit. Pourtant, l’appel de
l’accomplissement artistique est si fort que le jeune
garçon décide d’étudier pour entreprendre
une carrière de peintre, malgré l’opposition de son
père pourtant poète. Dès l’âge de
quatorze ans, il entend suivre des cours de dessin.
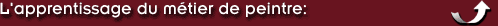
|
C’est donc en
1925 qu’il s’inscrit aux cours du soir du Monument National
sous la gouverne d’Adrien Hébert et de Johnny Jonhston qui
lui enseignent le dessin. Deux années plus tard, il
fréquente l’École des Beaux-Arts de Montréal
où Maurice Félix, Charles Maillard et Joseph
Saint-Charles assurent sa formation pendant trois ans,
c’est-à-dire jusqu’en 1927. Il y rencontre Stanley
Cosgrove et travaille déjà à
l’extérieur, réalisant des études «sur
le motif». Finalement, il va se perfectionner pendant cinq autres
années auprès d’Edmond Dyonnet.
LES EXPOSITIONS
Lors de cette période finale d’apprentissage faite
auprès de maîtres, il est accepté en 1931 au Salon
du Printemps tenu au Musée des beaux-arts de Montréal
où il sera encore présent en 1934, 1937, 1940, 1945,
1946, 1947, 1957 et 1963. C’est enfin en 1936 qu’il peut
présenter la première exposition de ses peintures
figuratives au Fine Art Department du magasin Eaton de Montréal,
au côté du paysagiste Marc-Aurèle Fortin.
Dès lors, il participe à un grand nombre de
manifestations, en solo ou en groupe, dont celle du Canadian Hall of
Fine Arts de Montréal, en 1945.
En 1947, il expose ses paysages à la Galerie Robert
Oliver et, en 1949, il se voit offrir une autre exposition
importante, à la Galerie Antoine de Montréal,
avant de faire un voyage d’études en France
et en Italie d’où il ramène plusieurs
toiles encore figuratives. L’année de sa neuvième
présence au Salon du Printemps de Musée
des beaux-arts de Montréal, il présente
en solo ses oeuvres au Centre d’art du Mont-Royal
et à la Galerie Zannetin de Québec.
C’est dans cette même galerie qu’il dévoile
pour la première fois, en 1965, des oeuvres de sa période
abstraite naissante, avec des toiles fortement gestuelles,
texturées et rythmées. Par la suite, outre deux
expositions à la Galerie Le Gobelet et au Foyer des Arts du
magasin Eaton, il est invité par le Gouvernement du
Québec à montrer ses toiles au Pavillon du Québec
de l’Exposition Universelle d’Osaka alors que la Galerie
Zannetin fait circuler une exposition itinérante de son travail.
Plus tard, au cours des années 90, il accroche ses collages et
ses constructions au Vieux Presbytère de Saint-Bruno, à
la Galerie de l’Alliance Française d’Ottawa et,
enfin, au Vieux-Palais de Saint-Jérôme, avec des oeuvres
d’Ayotte, Beaulieu, Cosgrove, Fortin et Lyman.
LA FORTUNE CRITIQUE
Tout au long de sa carrière, la couverture médiatique
des expositions de Joseph Giunta comprendra de nombreux
quotidiens, dont certains n’existent plus: La Presse,
La Patrie, Le Petit Journal, The Montreal Star, The Gazette,
Le Devoir, Quebec Chronicle Telegraph, Le Soleil et L’Action
Catholique. C’est d’ailleurs à l’occasion
de sa toute première exposition de 1936 au Fine
Art Department du magasin Eaton de Montréal, avec
Marc-Aurèle Fortin, que Joseph Giunta reçoit
ses premières critiques dans les quotidiens montréalais
Montreal Daily Star et The Gazette où l’on
s’attarde sur la variété de ses ressources,
la complexité de sa touche et son excellent sens
de la couleur.
À ces commentaires viennent s’ajouter, dans une
édition du journal Le Devoir de 1946, ceux ayant trait à
la poésie qui se dégage de ses tableaux et à son
esprit synthétique qui consiste à soumettre les
détails à l’ensemble, qualité qui sera
essentielle pour ses oeuvres de maturité. Une autre
référence à cette qualité apparaît
dans le même journal en 1949 quand il est question
«d’ordonnance des parties au tout».
Son passage à la période abstraite est souligné en
1964 dans La Patrie, sous la plume de Suzanne Lamer qui en retient la
force et la fougue alors que l’année suivante
L’Action Catholique de Québec s’attardera sur
l’importance de son exposition chez Zannetin.
D’après le quotidien, Giunta, avec ses
«poèmes plastiques», vient, par la matière,
de «trouver son expression véritable». Claude
Daigneault, dans Le Soleil, viendra compléter le portrait en
1973 lorsqu’il écrit que l’artiste est un
«constructeur», ce qui, somme toute, s’avère
être encore aujourd’hui le terme le plus pertinent
utilisé à son endroit.
Tout au long de sa carrière, Joseph Giunta a
réalisé des toiles figuratives inspirées de sujets
comme le paysage, l’atelier, la nature morte ou le portrait et
ce, même, depuis 1958, au travers de ses périodes
importantes d’abstraction et de construction
géométrique. Certes, cette constance peut surprendre mais
elle n’en trouve pas moins sa justification dans la pensée
créatrice de l’artiste. Car, même si la pratique de
ces genres correspond, d’une part, aux inévitables
années de jeunesse et, d’autre part, à certains
moments de besoins économiques critiques, elle convoque avant
tout le peintre dans un état de communion avec le monde, rendu
sans doute nécessaire pour nourrir sa vision prospective de la
matière picturale.
Dans cette perspective, on retient certaines oeuvres tardives dont la
figuration se démarque nettement de celle des premières
toiles où la représentation réaliste est
assujettie à une illusion de profondeur. Dans les huiles
intitulées Violon (1940), Port de Montréal (1963) et en
particulier Intérieur studio Giunta (1979), les divers motifs
s’affichent en réalité comme autant de
prétextes servant à construire un plan pictural
texturé qui ignore les effets de profondeur et se rapproche
nettement des conceptions abstraites du peintre.
Selon l’aveu même de Giunta, c’est vers
1958 qu’il fait ses premières tentatives d’abstraction
directement inspirées du monde qui l’entoure.
Tel Léonard de Vinci qui conseillait aux jeunes
peintres de découvrir des formes par l’observation
de vieux
murs ( 1),
il commence à s’intéresser aux textures
urbaines. Marchant sur un trottoir, par exemple, il y
voit des taches, des textures, des sinuosités,
des réseaux organiques ou géométriques
plutôt que le motif figuratif lui-même. Dans
la suite naturelle de cette démarche naissante,
il se met à ramasser des objets hétéroclites
sans pour autant déterminer l’usage qu’il
en fera dans ses tableaux. 1),
il commence à s’intéresser aux textures
urbaines. Marchant sur un trottoir, par exemple, il y
voit des taches, des textures, des sinuosités,
des réseaux organiques ou géométriques
plutôt que le motif figuratif lui-même. Dans
la suite naturelle de cette démarche naissante,
il se met à ramasser des objets hétéroclites
sans pour autant déterminer l’usage qu’il
en fera dans ses tableaux.
Cette attitude de cueillette, combinée à une attirance
croissante pour le seul jeu du
plan pictural et de la matière, se situe au coeur
de la personnalité artistique de Joseph Giunta
qui trouve sa plus belle manifestation dans les constructions
des années 70
et 80.
Il refuse ainsi une littéralité entraînant la
stricte fidélité à un sujet pour, au contraire,
soumettre les objets du monde à ce qui s’avère
être désormais l’aventure dont il fera sa marque: le
pur désir de la matière, celle qu’il utilise
à un moment donné, et l’autre, idéale, qui
reste à construire. Face à lui, « le grand pourquoi
n’existe pas» et il ajoute, «je suis
étonné qu’autant d’énergie soit
consacrée à la représentation alors,
qu’à l’inverse, il faut admirer l’effort
voué à faire quelque chose avec la matière. La
décision accompagnant un simple trait est déjà une
grande chose. On peut voir dans un ou deux traits une grande histoire.
Quelle est donc alors la pertinence d’un paysage ou d’une
tête?» ( 2).
Cette déclaration illustre bel et bien la conscience
aiguë de l’artiste face à l’aventure
moderne et certains de ses grands noms. Parmi ceux-ci,
Antoni Tàpies, pour lequel «la lutte avec
la matière doit s’ajouter à la réflexion» ( 2).
Cette déclaration illustre bel et bien la conscience
aiguë de l’artiste face à l’aventure
moderne et certains de ses grands noms. Parmi ceux-ci,
Antoni Tàpies, pour lequel «la lutte avec
la matière doit s’ajouter à la réflexion» ( 3),
affirme, un peu comme le fait Pierre Soulages, que c’est
au fur et à mesure de son travail que se formule
sa pensée. L’on croirait, ici, entendre Giunta. 3),
affirme, un peu comme le fait Pierre Soulages, que c’est
au fur et à mesure de son travail que se formule
sa pensée. L’on croirait, ici, entendre Giunta.
Cherchant lui aussi un équilibre résultant
d’une tension dynamique entre sa personne et la matière,
il se place également parmi les héritiers
de Paul Klee dont le précepte «l’oeuvre
n’est pas forme mais formation» ( 4) nous rappelle qu’une des caractéristiques
de la création contemporaine est celle de l’oeuvre
comme développement qui se détermine progressivement
en fonction de ses avancées. La peinture est, ici,
l’histoire de sa construction. C’est sans doute
la raison pour laquelle Giunta insiste souvent sur un
certain type d’action instauratrice de l’oeuvre
qui se veut, sous l’angle de la postmodernité,
la résultante d’un enchaînement de rencontres
qui n’existent a fortiori que par l’individu
qui les crée ( 4) nous rappelle qu’une des caractéristiques
de la création contemporaine est celle de l’oeuvre
comme développement qui se détermine progressivement
en fonction de ses avancées. La peinture est, ici,
l’histoire de sa construction. C’est sans doute
la raison pour laquelle Giunta insiste souvent sur un
certain type d’action instauratrice de l’oeuvre
qui se veut, sous l’angle de la postmodernité,
la résultante d’un enchaînement de rencontres
qui n’existent a fortiori que par l’individu
qui les crée ( 5) pour une occasion unique. Dans cette optique, dit-il,
«si je réfléchis trop et pense mon
tableau en termes d’explications progressives et
de conclusion, je n’arrive à rien».
Il y a donc, selon lui, «une autre personne qui
agit en vous quand vous changez une ligne, et c’est
là une façon de mieux se connaître».
C’est une opinion partagée par Matisse ( 5) pour une occasion unique. Dans cette optique, dit-il,
«si je réfléchis trop et pense mon
tableau en termes d’explications progressives et
de conclusion, je n’arrive à rien».
Il y a donc, selon lui, «une autre personne qui
agit en vous quand vous changez une ligne, et c’est
là une façon de mieux se connaître».
C’est une opinion partagée par Matisse ( 6)
et qui indique un autre aspect important de la pensée de ce
siècle que Giunta a tout à fait assimilée et mise
en chantier parallèlement à celui du jeu de la
matière: celle de l’artiste qui se construit au travers de
son oeuvre. Loin du concept de génie romantique
considérant la toile comme simple surface qui reçoit les
projections de sa personne, l’introspection accompagnant
l’aventure moderne permet, entre le tableau concret, le tableau
à faire et l’artiste, un échange constant pendant
lequel chacun des trois partenaires répond aux appels des deux
autres vers un accomplissement commun. En définitive, la
pensée artistique de Giunta souligne que
«l’important, pour le peintre, est de se mesurer dans son
action afin d’atteindre sa vérité et ses
émotions. L’oeuvre l’amène donc près
de lui-même, en son for intérieur». Faire oeuvre,
pour Giunta, signifie instaurer des objets de communion dans lesquels
le spectateur retrouvera l’espoir de l’imagination. Et
ceci, dans une optique des plus contemporaine; par la matière,
l’objet trouvé et le tableau qui se révèle
à lui-même. 6)
et qui indique un autre aspect important de la pensée de ce
siècle que Giunta a tout à fait assimilée et mise
en chantier parallèlement à celui du jeu de la
matière: celle de l’artiste qui se construit au travers de
son oeuvre. Loin du concept de génie romantique
considérant la toile comme simple surface qui reçoit les
projections de sa personne, l’introspection accompagnant
l’aventure moderne permet, entre le tableau concret, le tableau
à faire et l’artiste, un échange constant pendant
lequel chacun des trois partenaires répond aux appels des deux
autres vers un accomplissement commun. En définitive, la
pensée artistique de Giunta souligne que
«l’important, pour le peintre, est de se mesurer dans son
action afin d’atteindre sa vérité et ses
émotions. L’oeuvre l’amène donc près
de lui-même, en son for intérieur». Faire oeuvre,
pour Giunta, signifie instaurer des objets de communion dans lesquels
le spectateur retrouvera l’espoir de l’imagination. Et
ceci, dans une optique des plus contemporaine; par la matière,
l’objet trouvé et le tableau qui se révèle
à lui-même. |